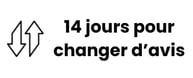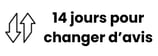Chapeau de fête, lettres superflues et cadeaux de Noël
D'où vient le chapeau pointu sur le "e" de fête ? Et d'où vient le mot "fête" lui-même? En cette période de cadeaux de Noël, laissez-moi vous raconter une histoire de lettres superflues...


Une occasion de faire la foire
Mais revenons au mot fête lui-même.
Avant de faire la fête, si nous faisions la foire ? Cette seconde expression, d’un registre de langue plus familier, permet de lier les deux mots, qui sont apparentés au niveau étymologique.
En effet, fête vient de l’adjectif latin festa, «de fête», quand foire voit son origine remonter au latin classique feriae, «jours de fête» – les foires avaient autrefois lieu lors de jours de fête, ou étaient un prétexte à la fête. Foires et fêtes se retrouvent ainsi solidement tissées ensemble : elles ont la même racine fes-, fas-. De même qu’un autre mot, également rattaché à cette racine : l’adjectif férié.
Foire, fête, férié… Il serait vain de s’opposer à l’héritage linguistique : les jours de fête sont bien des jours fériés, quoi qu’en dise votre patron. Cependant, je ne suis pas sûre que celui-ci sera très sensible à l’argument étymologique, si vous devez travailler un de ces jours-là – en tout cas, je décline toute responsabilité sur le sujet. On pourrait aussi demander à Madeleine, la Zigue syndicaliste, ce qu’elle en pense…
Bientôt Noël et le Nouvel An… Les traditionnelles célébrations de la fin de l’année sont le moment parfait pour se pencher sur un terme incontournable de cette période : le mot fête.
Des cadeaux pour les fêtes
Le début du mois de décembre est une période propice à l’anticipation des festivités à venir. Afin que vous puissiez trouver des idées de cadeaux originaux pour chacune et chacun, je vous ai confectionné une page spéciale «SOS Noël», avec des propositions thématiques.
N’hésitez pas à aller y jeter un œil !
Un chapeau de fête
Pour commencer, vous noterez que fête a sorti son chapeau de gala pour l’occasion, son chapeau pointu. Vous connaissez peut-être déjà l’histoire, certains accents circonflexes sont la marque d’un s étymologique passé : on trouve ainsi, vers l’an 1050, la trace la plus ancienne du mot feste, dans un texte en français médiéval assez obscur, Vie de saint Alexis.
L’accent circonflexe, lui, apparaît plus tardivement : c’est seulement au XVIe siècle qu’on a commencé à l’utiliser. Vers 1560, sous l’influence de Ronsard, un imprimeur tourangeau nommé Plantin va venir remplacer ce s par un accent circonflexe dans un certain nombre de mots. À cette époque, l’orthographe française est pour le moins… luxuriante : pour Plantin, les mots contiennent un «tas de lettres superflues» qu’il ne lui est «pas possible de plus longtemps souffrir». L’imprimeur souhaite simplifier la notation du français, notamment à l’intention des étrangers (des Hollandais, en particulier).
Lettre superflue parmi d’autres, le s de feste n’était en effet pas prononcé (en linguistique, on appelle cela une lettre «diacritique» : sa seule raison d’être est de préciser la prononciation de la voyelle précédente). C’est ainsi que l’on est passé de feste à fête. Cette réforme de l’orthographe ne sera, dans un premier temps, pas bien accueillie par le public français, mais c’est une autre histoire…
Curieusement, la lettre s diacritique est restée présente dans plusieurs mots de la même famille, où (enfin reconnue à sa juste valeur ?) elle a gagné le droit d’être prononcée. On la retrouve ainsi dans festivité, festival, festin… Le même procédé est à l’œuvre qui regroupe dans une même grande famille vêtement et veston, ou encore, en lien avec les préparatifs en cours, hôte et hospitalité.
Sources
Nina Catach et Jeanne Golfand, «L’orthographe plantinienne»
Dictionnaire culturel en langue française, éditions Le Robert
Madeleine, la Zigue syndicaliste


Illustrations
« Quatre accessoires de fête » : image d'upklyak sur Freepik
Texte et toutes les autres images : ©La Boîte à zigzag